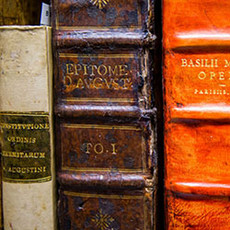Le Bénin, mémoires vivantes
L’exposition Bénin aller-retour, regards sur le Dahomey de 1930 dévoile un fonds majeur des collections du musée départemental Albert-Kahn, un ensemble de films et d’images foisonnant d’où émerge une culture méconnue et toujours bien présente : le vodún.
Rien dans le projet d’Albert Kahn de préserver par l’image ce qui dans le monde était en voie de disparition n’est ordinaire. Mais la dernière mission d’envergure qu’il a financée, avant que la crise n’emporte à la fois son monde et ses ambitions humanistes, est exceptionnelle à plus d’un titre. C’est d’abord la première - et donc la dernière - à explorer l’Afrique subsaharienne, après un certain nombre d’expéditions au Maghreb, en Égypte et dans les protectorats français de la Syrie et du Liban. « Des restrictions logistiques entrent probablement en jeu, nous renseigne David-Sean Thomas, commissaire de l’exposition aux côtés de Julien Faure-Conorton. En général, et hormis le cas de la Mongolie, les opérateurs travaillaient dans des conditions matérielles, sinon confortables, du moins assez établies, avec un itinéraire qui ressemble aux itinéraires touristiques. Tout ce qui concerne l’Afrique subsaharienne s’écarte des circuits de confort, notamment pour le transport du matériel. » Julien Faure-Conorton, chargé de recherche et de valorisation scientifique des collections du musée, poursuit : « L’Afrique est complètement sous les radars à l’époque, elle représente une forme d’inconnue. Les missions des Archives de la Planète sont liées aux réseaux diplomatiques et coloniaux d’Albert Kahn qui aidaient les opérateurs sur le terrain. A priori, il n’avait pas de contact en Afrique subsaharienne. C’est pourquoi le père Aupiais va mener la mission d’un bout à l’autre, Kahn se contentant de la financer. » Ainsi apparaît le nom de Francis Aupiais (1877-1945), prêtre des missions africaines, qui a passé plus de vingt ans dans ce qui s’appelait alors le Dahomey - le pays a été rebaptisé Bénin dans les années soixante-dix. Situation exceptionnelle pour les Archives de la Planète d’une personnalité extérieure sollicitant Albert Kahn pour une mission de plus de quatre mois où il sera accompagné du photographe et cinéaste Frédéric Gadmer (1878-1954). « Les théories du père Aupiais sur la culture du Dahomey rejoignent le projet des Archives de la Planète, suggère Julien Faure-Conorton. Il veut la documenter parce qu’il considère que l’européanisation va transformer la culture traditionnelle. Voilà un point de connexion. Il y a cependant une ambivalence chez lui. D’un côté, Aupiais a été envoyé pour convertir les Dahoméens au catholicisme, et donc transformer leur culture d’origine. Par ailleurs, il se passionne pour leur culture, il décide d’en montrer la qualité et d’une certaine manière de la préserver. Cette double direction, qui peut sembler contradictoire, fait justement l’un des intérêts du sujet. »
Pour la première fois, nous allons montrer les films numérisés en 4K, ce qui donne cette impression d’actualité vivante contemporaine.




Vous avez dit vodún ?
Le cœur battant de cette culture, dans le for intérieur du père Aupiais et dans les images qu’en rapporte Gadmer - un ensemble impressionnant de plus de mille autochromes et huit heures trente de films -, c’est le vodún, « à la fois une religion, un système de pensée, une façon de concevoir le monde. » Surgi des terres africaines autour du Bénin, le vodún a fait le voyage vers les Amériques dans le sillage morbide de la traite des esclaves ; il s’y est transformé à tel point que le vaudou haïtien, le plus connu aujourd’hui avec ses images de sorcellerie et de poupées inquiétantes, n’a plus grand-chose à voir avec celui d’origine. Julien Faure-Conorton : « Entre les hommes et une entité supérieure, il existe un certain nombre de forces incarnées principalement par des éléments de la nature. Ces divinités, ces “vaudous” font l’objet d’un culte dans un souci de protection. Les statuettes ou les monticules de terre ne sont pas le vaudou lui-même, juste la matérialisation de l’emplacement d’un lieu sacré et d’une présence. »
Deux missions sur le terrain en amont de l’exposition, la collaboration avec l’association Mewihonto qui travaille à la préservation du patrimoine béninois, un échange artistique sous forme de performance animée par l’artiste Bronwyn Lace et le Centre for the Less Good Idea de Johannesburg, l’appel aux connaissances d’un comité scientifique : l’exposition mérite bien son titre d’« aller-retour » entre le Dahomey des années trente et le Bénin du XXIe siècle. La confrontation du patrimoine avec des œuvres d’artistes béninois d’aujourd’hui qui s’en sont inspirés, comme Roméo Mivekannin, apporte un surcroît de sens à l’expression - chère aux équipes du musée départemental - de « réactivation » des Archives de la Planète. « Ce sont des archives vivantes que nous voulons partager dans cette exposition, soulignent les commissaires. Un des éléments essentiels, une première pour nos expositions, est que nous allons montrer les films numérisés en 4K, ce qui donne cette impression d’actualité vivante contemporaine, même si c’est muet, même si c’est en noir et blanc. On n’a plus du tout l’impression d’être en face d’images d’archives. En montrant ces films aux Béninois aujourd’hui, nous avons acquis la certitude que les cérémonies filmées suivent le protocole naturel et sont fidèles à la réalité du terrain. Oui, il y a des scènes qui sont rejouées, composées pour le cadre très restreint de la caméra et la longueur des bobines. Mais la “mise en scène” n’est pas une trahison, c’est une tentative de lisibilité. »
Didier Lamare pour HDS Le magazine du Département des Hauts-de-Seine
N°8 - Novembre/ Décembre 2025
Bénin aller-retour. Regards sur le Dahomey de 1930, musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt, jusqu’au 14 juin 2026.
albert-kahn.hauts-de-seine.fr
En partenariat avec
![]()
Le Monde
et
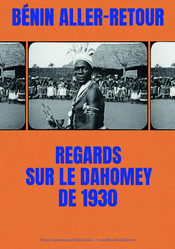 Écrit par des auteurs français et béninois, l'ouvrage scientifique qui accompagne l’exposition donne l’état de la recherche sur ce fonds et reproduit les principales œuvres exposées. Un livre « augmenté », doublé d’une extension numérique qui donne accès à des extraits des films de la mission, des œuvres contemporaines, des créations musicales et des contenus documentaires. Bénin aller-retour. Regards sur le Dahomey de 1930. Coédition musée départemental Albert-Kahn / GrandPalaisRmnÉditions, 25 €, 192 pages, disponible à la boutique du musée et en librairie. |